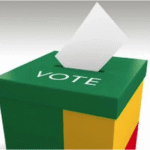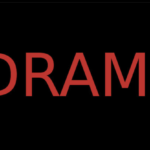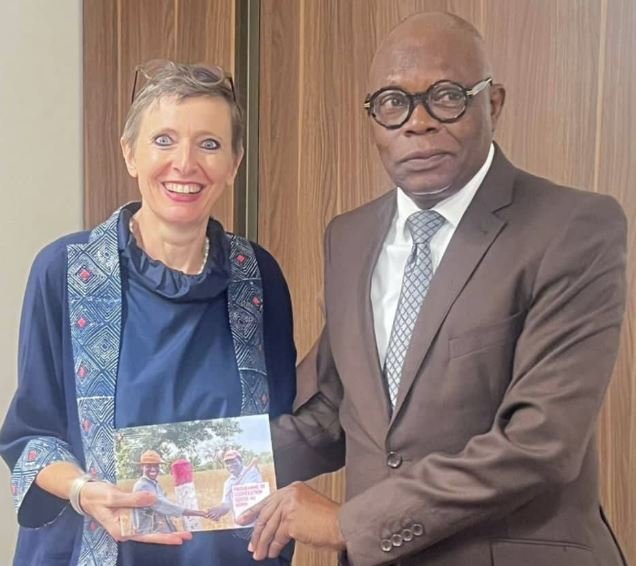Le gouvernement béninois a décidé de lever l’interdiction d’exportation des produits vivriers, une mesure qui avait été mise en place en 2023. Cette décision, loin d’être un revirement politique, s’inscrit dans une stratégie cohérente visant à concilier sécurité alimentaire nationale, développement industriel local et rigueur économique.
Une mesure temporaire devenue caduque
Lors d’une conférence de presse tenue le 4 juillet 2025 dans les locaux du journal Le Béninois Libéré, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole et Secrétaire Général Adjoint du gouvernement béninois, a tenu à clarifier la nature de cette interdiction. « Quand on a annoncé l’interdiction, ce n’était pas une interdiction formelle ni intemporelle. Elle est encadrée dans un délai », a-t-il précisé.
L’objectif initial était double : fournir en priorité les usines installées dans la zone économique spéciale de Glo-Djigbé et garantir l’approvisionnement du marché national. Cette stratégie visait à éviter que la production nationale soit entièrement exportée au détriment des besoins intérieurs et des projets d’industrialisation.
La lutte contre la fraude douanière
L’une des préoccupations majeures du gouvernement concernait les exportations frauduleuses par voie terrestre. « Ce que nous avons, par contre, formellement interdit, c’était les exportations par voie de terre », a souligné le porte-parole. Cette mesure ciblait spécifiquement les opérateurs qui préféraient faire sortir leurs produits par des pistes non officielles, échappant ainsi au contrôle douanier.
Cette pratique faussait non seulement les statistiques commerciales du pays, mais privait également l’État de recettes fiscales légitimes. En canalisant les exportations par le port de Cotonou, le gouvernement entendait mieux contrôler les volumes sortants et s’assurer que « ceux qui viennent chercher les produits paient ce qu’il faut ».
Un appel au patriotisme économique face aux critiques
Face aux critiques des commerçants préférant vendre à des acheteurs étrangers offrant de meilleurs prix, le porte-parole gouvernemental a rappelé l’ampleur des subventions publiques accordées au secteur agricole. « Pour la campagne agricole en cours, le gouvernement a mis 26 milliards de subventions », a-t-il souligné, précisant que ces fonds proviennent « de l’argent de tous les Béninois ».
Cette donnée est cruciale pour comprendre la position gouvernementale : l’État estime légitime que la production subventionnée serve d’abord les besoins nationaux avant d’être exportée. « Est-ce que ce serait responsable de laisser partir tout ? », interroge Wilfried Houngbédji, appelant les opérateurs à « ne pas s’enrichir au détriment des autres Béninois ».
Glo-Djigbé : symbole d’une ambition industrielle
La zone économique spéciale de Glo-Djigbé occupe une place centrale dans la stratégie gouvernementale. Cette zone industrielle est présentée comme la vitrine de la souveraineté industrielle béninoise et comme un moyen de rompre avec la dépendance extérieure.
« Ceux qui viennent acheter à des prix excessifs savent qu’ils vont récupérer chez eux en transformant », déplore le porte-parole, dénonçant une forme « d’impérialisme industriel » qui maintient le Bénin dans une position de fournisseur de matières premières.
Aujourd’hui, Glo-Djigbé transforme déjà le coton, le cajou et le soja béninois. Les uniformes des forces armées et de police sont même confectionnés sur place. « Demain, ce sera peut-être le maïs. Pourquoi pas ? », s’interroge avec optimisme Wilfried Houngbédji.
Une stratégie de transformation économique
La levée de l’interdiction d’exportation ne signifie pas l’abandon des objectifs de transformation locale. Au contraire, elle marque « le constat de la fin du délai » prévu initialement. Le gouvernement maintient sa politique de valorisation de la production nationale et de création d’emplois pour les jeunes.
Cette approche s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté alimentaire et industrielle. En encourageant la transformation locale avant l’exportation, le Bénin entend capturer davantage de valeur ajoutée de sa production agricole et créer des emplois qualifiés.
Défis et perspectives
La réussite de cette stratégie dépendra largement de la capacité des industries de Glo-Djigbé à absorber une partie significative de la production nationale. Il faudra également s’assurer que les prix offerts aux producteurs restent compétitifs par rapport aux marchés d’exportation.
Le gouvernement devra également maintenir un équilibre délicat entre la satisfaction des besoins du marché intérieur, les exigences des industries locales et les opportunités d’exportation. Cette approche nécessitera une coordination étroite entre les différents acteurs de la filière.
La levée de l’interdiction d’exportation des produits vivriers au Bénin illustre une approche pragmatique du développement économique. Loin d’être un revirement, cette décision s’inscrit dans une stratégie cohérente visant à concilier sécurité alimentaire, industrialisation locale et optimisation des recettes d’exportation.
Le succès de cette politique dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir l’équilibre entre ces différents objectifs tout en assurant la compétitivité de l’économie béninoise sur les marchés régionaux et internationaux. Glo-Djigbé reste au cœur de cette ambition industrielle, symbole d’un Bénin qui veut transformer ses matières premières plutôt que de les exporter brutes.